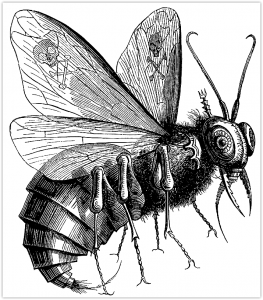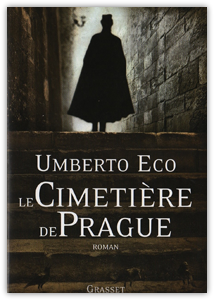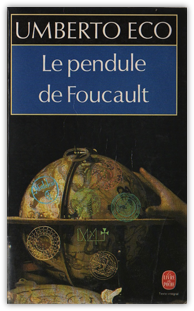Une œuvre à trois voix
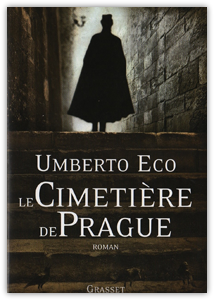 Le Cimetière de Prague
Le Cimetière de Prague est une œuvre à trois voix. Tout d’abord, celle d’un narrateur extradiégétique qui prend en charge l’ensemble du récit. Celle de Simon Simonini ensuite, le protagoniste de l’histoire. Celle de l’abbé Dalla Picola enfin, personnage « secondaire », qui n’est autre que le double de Simonini.
L’ensemble s’organise selon un journal fragmentaire dont le narrateur susmentionné rassemble les morceaux. En effet, Simonini – ayant rencontré Sigmund Freud – écrit ce qui lui reste de souvenirs, espérant retrouver la mémoire et comprendre son histoire en retrouvant le trauma dans lequel s’origine son amnésie. Dans le même temps, le diariste fait la découverte au sein même de son appartement d’un couloir menant à un autre appartement, celui de l’abbé Dalla Picola. Selon toute vraisemblance, Simonini et Dalla Picola ne forment qu’un seul et même schizophrénique personnage. L’un ne complétant le journal que lorsque le second est absent ou endormi.
Nous avons ainsi un étrange journal intime à deux voix qu’une troisième, celle du narrateur, ne jugeant pas suffisamment cohérent ou compréhensible, homogénéise pour en faire un récit malgré tout lacunaire, parcellaire, incomplet. C’est lui le responsable de la vis narrandi.
Un incipit labyrinthique
Cet enchevêtrement de voix (que la typographie, le style et le ton permettent de distinguer aisément) s’annonce en un début labyrinthique. On voit que, dans son dernier roman, Umberto Eco a abandonné l’image du portail (que le lecteur potentiel devrait franchir) pour céder la place à celle du dédale. N’en sortiront que les happy few, ceux que l’œuvre n’aura pas rebutés. Pour découvrir l’histoire du Cimetière de Prague, il faut donc suivre le narrateur dans un entrelacs de venelles qu’un conditionnel passé révèle improbable : « Le passant qui en ce matin gris du mois de mars 1897 aurait traversé à ses risques et périls… ». S’ensuit une traversée des « rares endroits de Paris épargnés par les éventrements du baron Haussmann » menant à une vitrine de brocanteur, officine du faussaire Simonini.
La brocante comme métaphore littéraire
Le bric-à-brac sans valeur qu’on y trouve, c’est tout le matériau narratif du livre, car Le Cimetière de Prague n’est rien d’autre que le recyclage de la production livresque du XIXe qu’elle soit littéraire, pamphlétaire, propagandiste, épistolaire, etc. Le mot « recyclage » n’a d’ailleurs aucune connotation péjorative. Le protagoniste – gagnant sa vie en créant de faux textes brandissant des menaces judéo-maçonniques – ne fait pas autre chose (« N’es-tu pas, toi, le maître du recyclage ? », demande-t-on à Simonini, page 427)
Ce livre, qui fait ainsi le récit de la genèse et du développement de l’antisémitisme, rassemble cette production hétéroclite qu’elle ait une valeur littéraire ou non. On y trouve pêle-mêle les livres les moins lus des grands auteurs (Les Mystères du peuple d’Eugène Sue, Joseph Balsamo d’Alexandre Dumas), mais aussi ces curieux objets sinon « littéraires » du moins historiques que sont Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly, Les Mystères de la Franc-Maçonnerie de Léo taxil, Le Diable au XIXe siècle du docteur Bataille, La France juive d’Édouard Drumont, etc. Simon Simonini, sycophante, faussaire, assassin et antisémite, est ce curieux héros qui pour vivre fait la lecture de tout cela, et produit des textes susceptibles de servir les intérêts des services d’espionnage ou de contre-espionnage agitant des menaces fantasmatiques.
La menace

Umberto Eco a souvent parlé dans ses livres des Supérieurs Inconnus (notamment dans
Le Pendule de Foucault). Ils sont évidemment dans
Le Cimetière de Prague.
En 1789, le marquis de Luchet avertissait : « Il s’est formé au sein des plus épaisses ténèbres, une société d’êtres nouveaux qui se connoissent sans s’être vus […] Cette société adopte, du régime jésuitique, l’obéissance aveugle ; de la franche-maçonnerie, les épreuves et les cérémonies extérieures ; des Templiers, les évocations souterraines et l’incroyable audace. » (Essai sur la secte des illuminés, cité par Umberto Eco dans Six promenades dans les bois du roman et d’ailleurs, page 176).
Tout l’enjeu du Cimetière de Prague est de montrer comment le XIXe siècle a ajouté les Juifs à cette illusoire menace. Je ne vous ferai pas le récit qui montre comment l’on va de Luchet à Rachkovsky en passant par Barruel, Simonini, Joly, Goedsche, etc. En revanche, ce qu’il faut comprendre, c’est le mécanisme qui favorise l’irruption de la fiction dans la réalité, celle-là même qui mène à Hitler ayant lu les Protocoles des Sages de Sion. Si vous n’avez pas le temps de lire Le Cimetière de Prague, lisez les pages 174 à 185 de Six promenades dans les bois du roman et d’ailleurs datant de… 1994.
Vingt-six après
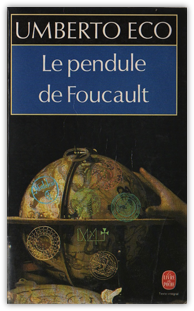
Pourquoi Umberto Eco a-t-il attendu près de 30 ans pour raconter et amplifier cette histoire afin d’en faire un roman de plus de 500 pages ? Une bonne partie du matériau employé dans
Le Cimetière de Prague ne figurait-il pas déjà dans
Le Pendule de Foucault publié en 1988 ?
On trouvera que, chez les grands écrivains, il y a une grande et unique obsession, ici déclinée en plusieurs ouvrages. Après tout le thème n’est-il pas fascinant ? Il suffit de nommer une chose pour qu’elle existe ! Inventez un improbable complot mondial, pluriséculaire, et tout le monde d’y croire ! Le faux devient vrai. L’obsession flaubertienne d’Eco pour l’erreur, la mauvaise foi, la stupidité se manifeste dans toute son œuvre : dans Les Limites de l’interprétation, l’auteur a élaboré une théorie du faux et des faussaires, dans Le Pendule de Foucault sont évoqués ces occultistes qui croient fanatiquement à tout, dans Baudolino, le personnage principal est un rêveur qui affabule…
Mais peut-être y a-t-il aussi chez Eco une vertu pédagogique ? Ne s’agit-il pas – une énième fois – de s’interroger sur les événements qui ont mené à l’holocauste : « Réfléchir sur les rapports complexes entre lecteur et histoire, entre fiction et réalité, constitue une forme de thérapie contre tout endormissement de la raison, qui engendre des monstres » (op.cit., page 183). C’est d’autant plus important que le monstre, « il est encore parmi nous » (Le Cimetière de Prague, page 545)
Mais cette interrogation est d’autant plus fascinante pour l’homme de lettres qu’il constate que la littérature, fût-elle mauvaise, a un réel pouvoir sur la vie. Cela est rendu possible par la crédulité de ceux qui sont incapables d’accepter le monde tel qu’il est, qui faute de pouvoir le refaire, le réécrivent (et ils sont légion ces gens qui ne voient que manipulation et complot). Ce à quoi, Umberto Eco répondait : « Il faut nécessairement qu’il y ait, associé à l’acte de création, un mystère. Le public le réclame. Sinon comment Dan Brown gagnerait-il sa vie ? » (N’espérez pas vous débarrasser des livres, page 174).
En ce cas, Le Cimetière de Prague n’est-il pas la dernière œuvre romanesque d’un homme de 80 ans qui chatouille de son érudition les déchets romanesques d’un écrivain qui marche maladroitement sur ses plates-bandes ?
« Dieu sait si les cimetières sont paisibles : il n’en est pas de plus riant qu’une bibliothèque. »

On a vu que
Le Cimetière de Prague était une véritable brocante littéraire constituée d’objets hétéroclites. Cette métaphore montre que des objets usés vendus au prix du neuf et parfois plus cher (je n’ai plus la référence exacte du livre) représentent des textes parfois anciens réutilisés, réécrits, plagiés pour en faire du neuf. Pensez aux
Protocoles des Sages de Sion.
Ce n’est pas la seule métaphore qui sous-tend le livre. Celle du cimetière donne également son titre à l’ouvrage. Ce cimetière praguois où les Supérieurs inconnus sont devenus des rabbins représente la bibliothèque (c’est d’ailleurs là que Simonini y fait ses recherches sur le cimetière). Se développant dans le cadre du « périmètre autorisé », l’auteur y a « superposé » ses livres (cf. pages 252 et 253). Le Cimetière de Prague est le lieu de réunion des rabbins comploteurs. C’est de ce lieu que tout part, de ce monument abritant la tombe de l’auteur du Golem, « créature monstrueuse destinée à accomplir les vengeances de tous les Israélites ». Et Simonini de conclure : « Mieux que Dumas, et mieux que les jésuites » (les jésuites font référence au complot imaginé par Eugène Sue dans Le juif errant).
Plus encore, le cimetière est LA création littéraire.
Ainsi, la culture livresque d’Umberto Eco est un défi jeté à la face des grands auteurs ou plus exactement ou même modestement une imitation amoureuse des feuilletons-romans, comme on disait encore à l’époque.
Pourtant, je crois pouvoir affirmer que je n’ai pas éprouvé particulièrement de plaisir à lire ce monument d’érudition. Le Cimetière de Prague est une œuvre fascinante, chaque péripétie recèle une référence. C’est le royaume de l’intertextualité. Tout ce qu’on lit peut être extrait d’un autre ouvrage. Par exemple, les égouts évoquent la traversée de Jean Valjean dans l’antre du Léviathan (Les Misérables), les épisodes sur la Commune évoquent… eh bien je ne sais plus (désolé, mais si quelqu’un peut me dire où j’ai déjà lu ça : « Le mardi, Montmartre était conquise et quarante hommes, trois femmes, quatre enfants avaient été amenés là où les communards avaient fusillé Lecomte et Thomas, agenouillés et fusillés à leur tour », page 317). La période des attentats des anarchistes, et notamment le malheureux journaliste qui, après avoir exalté les attentats, perdit un œil (cf. page 443) se trouve dans Le mouvement anarchiste en France de Jean Maitron. Ou encore la messe noire provient certainement en partie de Là-bas de Huysmans…
Le véritable plaisir de lecture est alors la recherche des références. Le reste est austère, aride. À aucun moment, on a envie de tourner la page, avide de savoir comme on peut avoir envie de savoir ce que vont devenir les fillettes pourchassées par le terrible père Rodin dans Le juif errant, ou comment la reine va réagir aux déclarations prophétiques de Joseph Balsamo dans l’ouvrage du même nom.
Peut-être cela vient-il du fait qu’Umberto Eco n’a pas la moindre sympathie pour son répugnant personnage, et qu’on ne le suit qu’à contrecœur ? Ou alors que l’auteur est un brillant universitaire possédant sa narratologie sur le bout des doigts, mais qui ne parvient pas à insuffler une once de suspense ? Je ne sais pas, mais assurément Le Cimetière de Prague est une œuvre fascinante, non passionnante.