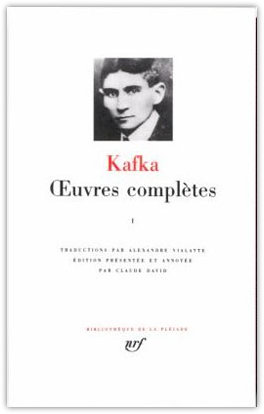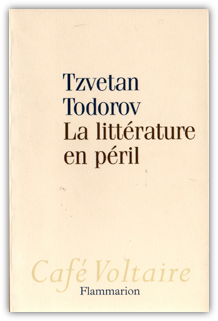 Il y a quelque temps, je lisais un article à propos de Michel Foucault sur le site du Monde diplomatique. L’auteur de cet article évoquait Derrida, lequel trouvait que L’histoire de la folie à l’âge classique relevait du « totalitarisme structuraliste ».
Il y a quelque temps, je lisais un article à propos de Michel Foucault sur le site du Monde diplomatique. L’auteur de cet article évoquait Derrida, lequel trouvait que L’histoire de la folie à l’âge classique relevait du « totalitarisme structuraliste ».
Stupeur ! car pour ma part je ne vois pas en quoi le structuralisme peut relever du totalitarisme, à moins qu’il ne s’agisse d’un emploi métaphorique.
Je fais part de cet article à mes collègues, dont l’une me parle aussitôt du petit livre de Tzvetan Todorov paru en 2006 La littérature en péril, dans lequel sont expliqués les liens qui unissent structuralisme et communisme.
Au début de son livre, Todorov explique que les études littéraires étaient « sous l’emprise de l’idéologie officielle », c’est-à-dire celle de la Bulgarie faisant alors partie du bloc communiste en 1956. Il explique également comment il devait réussir le tour de force de parler de la littérature sans bien sûr énoncer la moindre idée personnelle contrevenant à l’idéologie communiste, mais sans non plus « avoir à se plier aux exigences de l’idéologie régnante » c’est-à-dire sans à avoir à exprimer la foi communiste.La solution était simple. Comme l’avaient fait dans les années 20 les formalistes russes, il s’agissait de ne s’intéresser qu’à « la matérialité même du texte, à ses formes linguistique », « à s’occuper d’objets sans teneur idéologique ». Ainsi les observations littéraires échappaient à la censure.
On voit ainsi comment le structuralisme, le formalisme ou toute manière de ne s’intéresser qu’à la forme pure étaient au départ un moyen d’échapper à l’emprise du parti. Plus tard, elle sera un rééquilibrage, une approche conciliant étude du contexte historique, idéologique, esthétique (soit la tendance dominante de la critique à l’époque) et étude de la relation des éléments de l’œuvre entre eux (la tendance de la nouvelle critique, celle de Barthes, Genette, Todorov…).
Je ne suis pas sûr que cela explique la critique de Derrida, que je ne suis pas sûr d’avoir comprise, mais la suite du livre de Todorov est intéressante. Ce dernier pense que l’enseignement ( que ce soit dans le secondaire, à l’université… ) est le reflet d’une conception étroite de la littérature qui considère l’œuvre littéraire comme un objet auto-suffisant, sans rapport avec le monde, fait de jeux formels dont les règles internes prévalent. En classe, on étudie des situations d’énonciation, des genres, des registres, des figures de style, des points de vue, les fonctions de Greimas, les fonctions du langage de Jakobson, bref des concepts forgés par l’analyse littéraire mais pas les œuvres. Le pire est que cela conduit à un désintérêt pour la littérature, ce que la désaffection pour les filières littéraires semble confirmer.
On confond donc le but et le moyen, les outils avec l’objet : « À l’école, on n’apprend pas de quoi parle les œuvres mais de quoi parlent les critiques » (page 19) ; « […] les études littéraires ont pour but premier de nous faire connaître les outils dont elles se servent » (page 18).
Mais, la majeure partie du livre de Todorov n’est pas constituée de ce constat qui tiendrait en une dizaine de pages. Il ne crie pas non plus haro sur le structuralisme ( comment le pourrait-il ? ) qui pourrait facilement être désigné comme le coupable des dérives susmentionnées. Il montre comment on en est arrivé à cette situation. Et alors qu’on pouvait penser que le structuralisme endosserait le rôle du coupable idéal, Todorov montre comment la naissance de l’esthétique moderne à contribué à façonner la notion de Beau, d’Art, et donc d’œuvre auto-suffisante, coupé du monde. De Platon à la théorie de l’art pour l’art, il explique comment l’enseignement et la critique en sont venus à privilégier l’œuvre et ses jeux formels comme un objet clos et non comme « un discours sur le monde » (page 31), ce qu’elle est avant tout.
Je ne peux résumer toutes ces pages ( 37 à 68 ), mais elles valent d’être lues, et on ne pourra ainsi pas accuser le structuralisme de tous les maux.
Enfin Todorov montre pourquoi la littérature est en péril. Selon lui, elle est prise dans un « corset étouffant », « fait de jeux formel, complaintes nihilistes et nombrilisme solipsiste » (page 85).
Pourtant, le structuralisme a beaucoup apporté. Il faut se souvenir de ce qu’était la critique littéraire auparavant. Pensez à la philologie. Relisez Contre Sainte-Beuve. Mais Todorov prévient en s’opposant à tout manichéisme : « on n’est pas obligé de choisir entre le retour à la vieille école du village, où tous les enfants portent la blouse grise, et le modernisme à tous crins ; on peut garder les beaux projets du passé sans avoir à conspuer tout ce qui trouve sa source dans le monde contemporain » ( page 24 ).
Au reste, le structuralisme a-t-il été autre chose qu’une tentative de déchiffrer le monde, de lui donner du sens ? Ne serait-il pas paradoxal que l’on fasse le procès de ce qui n’a jamais été autre chose qu’« un discours sur le monde » ? Cherchant à définir l’homme structural, Roland Barthes le désignait ainsi, Homo significans, percevant « le frisson d’une machine immense qui est l’humanité en train de procéder inlassablement à une création du sens » ( » L’activité structuraliste » in Essais critiques, pp. 218-219). Et parlant de la littérature, Barthes écrivait « qu’elle est à la fois intelligible et interrogeante, parlante et silencieuse, engagée dans le monde par le chemin du sens qu’elle refait avec lui, mais dégagée des sens contingents que le monde élabore » ( c’est moi qui souligne ).


 Aujourd’hui, j’ai envie d’entamer un chant de louange et d’allégresse à l’iPod.
Aujourd’hui, j’ai envie d’entamer un chant de louange et d’allégresse à l’iPod. J’ai fini par en acquérir un, puis deux, puis trois, véritable tonneau des danaïdes. Jamais remplis. Je passe mon temps à déverser là-dedans toutes sortes de fichiers. Et depuis l’iPod touch, les possibilités se sont accrues.
J’ai fini par en acquérir un, puis deux, puis trois, véritable tonneau des danaïdes. Jamais remplis. Je passe mon temps à déverser là-dedans toutes sortes de fichiers. Et depuis l’iPod touch, les possibilités se sont accrues.